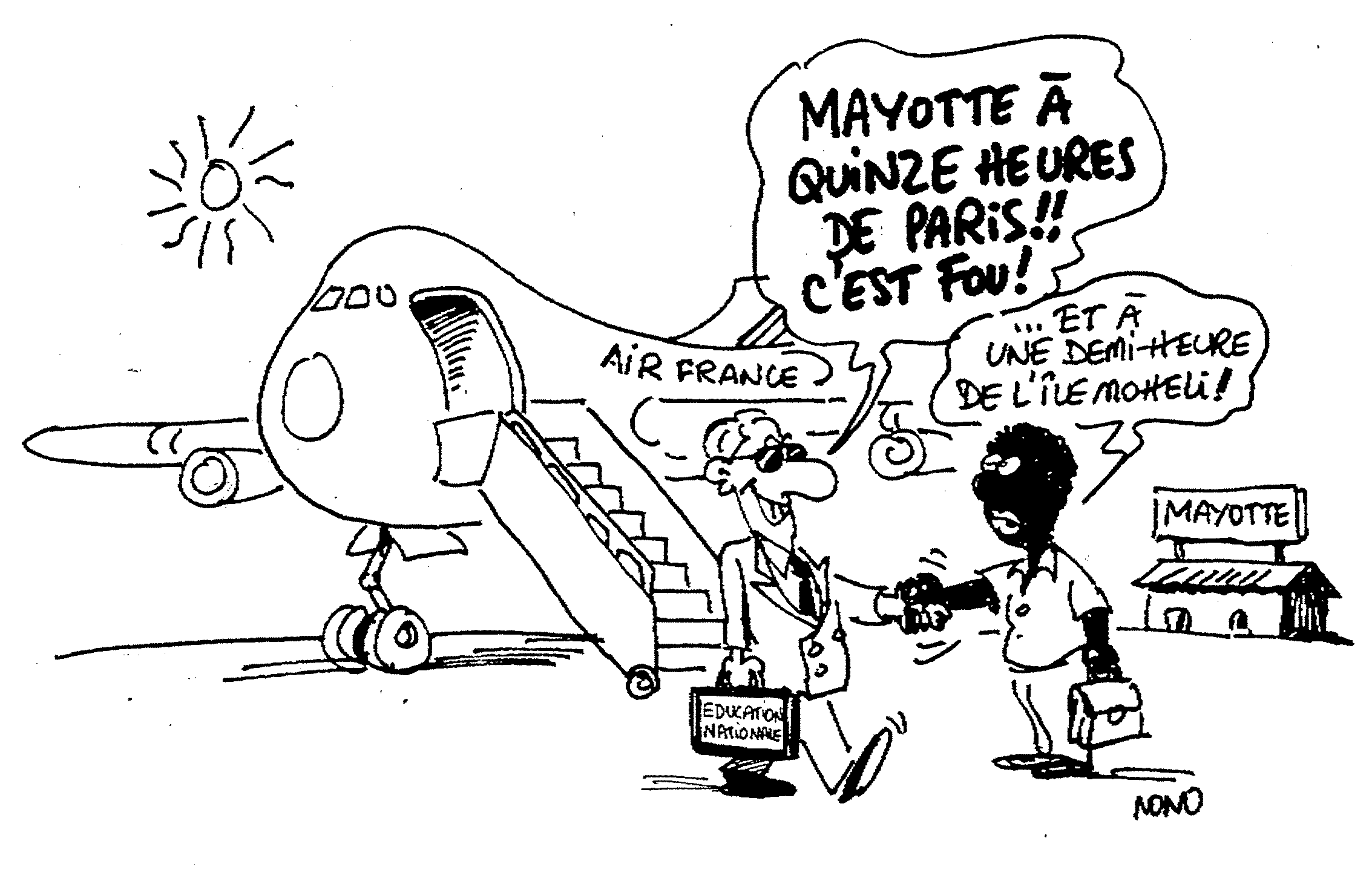|
INFORMATION ÉTRANGER |
Attention : le forum sur la toile est désormais sur <http://egroups.fr/group/sgen-etranger>
-
Pour imprimer ce bulletin (format Adobe
Sommaire de ce numéro
- Editorial
- XVIe congrès annuel du SGEN-C.F.D.T de l’Étranger
-
Lettre ouverte à Monsieur le Ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie
-
IIIe Congrès C.F.D.T. MAE
-
Non-cumul de retraite des fonctionnaires détachés hors de France
Notre éditorial
Blocage des négociations à l’A.E.F.E., démolition de l’assistance technique, accroissement de la précarité des recrutés locaux, développement de particularismes inquiétants dans les Territoires d’Outre-mer (TOM), les sujets d’inquiétude et d’irritation ne manquent pas à l’aube de cette nouvelle année scolaire.
Plus que jamais, il nous appartient d’être vigilant et déterminé. C’est dans cet état d’esprit que le secrétariat général s’est mis au travail, participant à de nombreuses réunions avec l’administration (A.E.F.E., D.G.A., D.G.C.I.D.), ainsi qu’avec nos partenaires des autres syndicats (FAEN, FSU, FEN).
L’action intersyndicale, nous y sommes attachés et en faisons notre règle tant que le mandat reçu de nos adhérents nous y autorise. Le cas échéant, nous ne manquerons pas, cependant, d’exprimer nos différences de conviction (cf. négociations à l’A.E.F.E.).
Cette vigilance et cette détermination, plus que jamais nécessaires, certaines sections ou adhérents isolés en font déjà preuve. Comptes-rendus de réunion, demandes informations remontent au secrétariat général qui s’efforce de réagir ou de répondre dans les meilleurs délais. Cet échange est indispensable. Il garantit l’adéquation du travail des représentants locaux et nationaux aux préoccupations de nos adhérents.
Bonne année scolaire à tous.
Pour comprendre les sigles et acronymes : notre siglaire !
Le compte-rendu du XVIe congrès annuel du SGEN-C.F.D.T de l’Étranger
Ordre du jour
Mardi 29 août 2000 (9 h – 18 h 00)
· Présentation du rapport d’activité et du rapport moral du secrétariat national et des sections
· Développement de la syndicalisation: nouveaux militants, nouveaux adhérents, fonctionnement des instances locales et nationales du syndicat
· Orientations du SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger pour les années 2000-2003:
o Enseignement français à l’étranger
§ Statut et rémunération des personnels A.E.F.E. (révision des textes de 1990)
§ Place du SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger et rapport avec les autres partenaires
Mercredi 30 août 2000 (9 h – 13 h 00)
· Orientations du SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger pour les années 2000-2003:
o La Coopération internationale (culturelle, universitaire, éducative, linguistique, scientifique, technique) et ses personnels
o Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna: quelle action syndicale spécifique pour le SGEN-C.F.D.T.?
· Renouvellement des instances du SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger.
Mercredi 30 août 2000 (14 h30 - 18 h 00)
· Partie commune à la branche « coopérants » du syndicat C.F.D.T. des Affaires étrangères et au SGEN-C.F.D.T. de l’étranger.
Retour au sommaire Retour à la page d'accueil
Rapport d’activités et rapport moral du secrétariat national
Avant de passer à l’examen des différents rapports, des remerciements particulièrement marqués sont adressés à Monique El Qacémi qui a assuré la continuité du fonctionnement syndical, dans des conditions particulièrement difficiles pendant l’année, avec un poids d’activités et une charge de travail bien au-delà de son temps de décharge de ses activités professionnelles.
L’intérêt du développement de
l’outil Internet (site web, messagerie électronique, forum de discussion) a été
souligné par tous les participants. Les adhérents se sentent moins isolés,
peuvent suivre de plus près l’actualité syndicale, ce qui a été
particulièrement important pendant cette année pleine de difficiles
négociations avec l’A.E.F.E.
Rapport moral et rapport d’activités
Les documents qui avaient fait l’objet d’un supplément spécial à SGEN-C.F.D.T. Information Étranger disponible sur Internet et envoyé sur simple demande sont présentés et commentés par le secrétaire général sortant avant un débat général et un vote.
Rapport financier
Monique El Qacemi, trésorière, souligne l’augmentation des dépenses par rapport aux recettes. Ce n’est pas encore visible sur le compte grâce aux provisions faites les années précédentes. Or pour l’année qui vient, il faut prévoir d’importantes dépenses pour la campagne électorale pour les élections aux instances paritaires de l’A.E.F.E. Ces dépenses seront entièrement à la charge du SGEN Étranger.
Vu la forte augmentation du reversement à la confédération (le prélèvement est passé de 70 % à 76 % du montant des cotisations) il faudrait voir s’il est possible d’envisager une demande de réduction de ce reversement dans la mesure où les frais sont plus importants que pour un syndicat en France (missions de France à l’étranger ou inversement).
Retour au sommaire Retour à la page d'accueil
Rapport d’activités des sections
Bruxelles
L’année a été agitée au lycée français de Bruxelles. L’application de la circulaire de l’A.E.F.E. sur la prime de cherté de vie a provoqué un conflit avec le proviseur. Le dossier ne pouvant être réglé par la négociation l’entente intersyndicale a lancé un mot d’ordre de grève qui dans l’ensemble a été bien suivi. La dureté du conflit est allée jusqu’à la menace de grève illimitée. Il a fallu le déplacement à Bruxelles de Monsieur DEBAERRE pour apaiser les choses et faire aboutir les négociations.
Françoise Fournié
Grèce
Lycée français d’Athènes: Dans l’ensemble, l’année a été calme, d’autant plus que nous avons un proviseur qui communique correctement avec les syndicats et qui sait négocier. L’absence de conflits locaux et le calendrier scolaire qui était à contre-pied des dates de grève n’ont pas favorisé la mobilisation sur les problèmes liés aux négociations sur la situation dans l’Agence. La section a augmenté ses effectifs, en particulier avec une percée dans le primaire; A l’Institut français d’Athènes où la section SGEN a disparu depuis plusieurs années (Les personnels s’étant syndiqués pour des raisons de tactique locale) le conflit qui avait duré des années autour du maintien ou de la suppression de postes se termine par un plan qui amène la réduction des effectifs et de nombreux départs.
Constantin Kaïteris
Abidjan :
Le nombre important d’établissements français à Abidjan fait qu’il y a eu une forte participation au mouvement de revendication. les deux grèves ont été bien suivies. En ce qui concerne la prise en charge des frais de scolarité, la position retenue par l’A.E.F.E. n’a pas été jugée totalement satisfaisante. Une prise en charge des frais réels serait préférée.
Lycée Blaise Pascal : en ce qui concerne la prime de cherté de vie, l’association des parents d’élèves refuse de la prendre en charge et même d’en discuter. Le président de l’association a obtenu du directeur de l’A.E.F.E. que celle-ci soit payée par l’Agence. Un conflit a éclaté sur le problème des recrutés locaux : le directeur d’établissements veut inscrire sur le contrat qu’au cas où un titulaire de l’éducation nationale présente sa candidature sur le poste objet du contrat il sera mis fin au contrat.
Cette position est inacceptable et par les organisations syndicales et par l’Association des parents d’élèves.
Daniel Moreau
Madrid :
Au lycée français de Madrid, nous agissons en intersyndicale pour tout ce qui est relatif au système éducatif français (SGEN, SNES, SE-FEN et même SUD (2 adhérents) et avec les syndicats espagnols pour le reste des problèmes. Depuis l’arrivée de Madame Ciznar Winkler l’année dernière, nous sommes sur le pied de guerre en permanence : pas de concertation, mépris des syndicats, autoritarisme comme on en n’avait jamais connu jusque-là, d’où grève locale suivie à 80 pour cent année dernière contre sa gestion.
Cette année, ça continue, et les services culturels, non contents de l’appuyer, en rajoutent de leur côté. Dès la rentrée, trois batailles qui nous ont pris du temps et de l’énergie :
1°) on apprend que les faux résidents ne touchent plus le salaire de grade, mais celui des recrutés locaux. Les services culturels ont pris seuls la décision, sans avertir qui que ce soit, soi-disant parce que les syndicats catalans du lycée de Barcelone s’étaient plaints qu’ils (les faux-résidents) bénéficient d’un traitement différent. Quel prétexte génial et avec quel empressement les services culturels ont voulu donner satisfaction aux syndicats espagnols ! La compensation demandée à M. Verclytte n’a pas abouti.
2°) notre proviseur a essayé d’imposer sa carte scolaire en ne la soumettant pas au conseil d’établissement sous prétexte que les délais imposés par M. Verclytte étaient trop courts. Nous avons dénoncé la chose et envoyé à l’agence notre contre-proposition et nos amendements.
Le projet d’établissement 2000/2003 a été lancé, organisé et menée d’une façon tellement cavalière par le proviseur (catégories de personnels exclues, absence de bilan du projet antérieur, axe de travail rajouté par elle, délais dérisoires pour la mise en place, etc.) que nous avons fait circuler une motion dénonçant point par point tous les motifs de mécontentement : 75 pour cent du personnel a signé, mais il nous a fallu quasiment une année pour obtenir que cette motion accompagnée des 270 signatures soit transmise au conseil d’établissement et à l’Agence.
Par ailleurs, il a fallu se battre contre la politique d’obstruction systématique sur la formation continue : places limitées abusivement, tentative de dissuasion, absence d’informations sur les stages, etc.
Puis sur l’absence de transparence en matière de recrutement des recrutés locaux français (qui en principe doivent passer par la CCPL) et à des remplaçants des primaires.
Plus généralement, sur la façon autoritaire et méprisante de traiter les individus : intimidation des collègues et que l’on menace de licencier, décision prise sans consulter les intéressés est toujours en fonction de critères financiers.
Quant aux problèmes relatifs à la France, nous avons fait 2 jours de grève contre Allègre, et envoyé 2 lettres aux différents ministres concernés et à l’Agence, lettres que j’ai envoyées par mél au SGEN de l’étranger, ainsi que 2 lettres relatives aux revendications sur la situation des résidents et recrutés locaux de l’étranger. Nous n’avons pas fait la grève de juin mais nous avons convoqué l’heure d’information syndicale et organisé une assemblée générale. (Ici tout le personnel, sauf les expatriés, a la scolarité gratuite, grâce à la législation espagnole). Mon ordinateur étant en panne, je ne peux faire un envoi groupé de toutes ces lettres, et motions, mais vous devez les avoir dans le courrier électronique du SGEN de l’étranger.
Côté espagnol, nous suivons de près le conflit qui oppose nos collègues à la direction. Nous nous réunissons en intersyndicale très régulièrement. Le conflit concerne : horaires et salaires des agents, et remise en cause de l’accord passé en 1995 pour les enseignants.
La rentrée décrétée le 1er septembre par l’Agence pour les enseignants de l’étranger m’a fait renoncer à aller au congrès et je le regrette d’autant plus que j’avais souhaité que nous trouvions un moment pour débattre de l’affaire CFDT/ MEDEF de cet été, affaire qui, je le confesse, ébranle fortement mon désir de continuer dans un syndicat solidaire statutairement des agissements de la CFDT. La première réunion de rentrée traitera du sujet et les collègues de Madrid, tout comme moi, sont depuis longtemps frileux vis-à-vis de la politique de Nicole Notat en général.
Michèle Pénalva.
Maroc :
L’année a commencé par une tension entre syndicats. Suite au mouvement de mai-juin 2000 qui avait vu une mobilisation très importante (sans précédent sur un mot d’ordre international), il avait été décidé une grève dès la rentrée pour montrer que nous tenions à voir avancer vite les négociations.
La lettre de M. Verclytte du mois de juillet avait amené la F.S.U. nationale à demander à la F.S.U.-Maroc de se désengager du mouvement : exécution, d’où une assemblée générale houleuse (après des réunions SNES non moins houleuses). Le mouvement a été enterré puisque le mot d’ordre était résolument unitaire. Personne ne voulait d’une action en ordre dispersé. Il y eut donc une démobilisation, de l’amertume et un « front de non-syndiqués » s’est renforcé, on le retrouvera par la suite.
Le trimestre s’est déroulé dans une atmosphère riche en invectives et en mots aigres-doux.
Les sections au Maroc :
Il y eut la renaissance d’une section SGEN-C.F.D.T. au lycée Lyautey à Casablanca, toujours personne (sinon un correspondant) à Descartes, Rabat. Une collègue du SGEN assure l’affichage et la présence de notre syndicat à Marrakech.
Le premier degré, malgré de très nombreux départs vers d’autres cieux, se maintient, d’où la nécessité d’une tournée régulière des écoles (très forte présence du SNUIPP depuis 3 ans avec l’arrivée de nombreux jeunes résidents majoritairement au SNUIPP).
A.E.F.E. et négociations autour de la prime de cherté de vie et du décret 90 :
Le round de négociations sur la PCV s’est terminé par le refus des syndicats d’accepter une mesure qui se traduirait au Maroc par une perte de la moitié de l’enveloppe actuelle.
Il y eut une mobilisation correcte mais sans plus pour les grandes grèves nationales qui ont abouti au départ d’Allègre et à l’arrivée de Lang.
J’ai beaucoup demandé (sans être entendu au début) que cette mobilisation s’oriente plutôt sur nos revendications A.E.F.E. (qui étaient aussi un problème de moyens…).
La mayonnaise a vraiment pris après la grève internationale et les reports répétés de réunions A.E.F.E.
L’assemblée générale de Casablanca s’est dotée d’une coordination dont vous avez eu les compte rendus par courrier électronique. Cette coordination a permis d’intégrer le très fort contingent de non-syndiqués (méfiants depuis la rentrée sur les manœuvres syndicales.).
La section SGEN de Lyautey a décidé d’être partie prenante de cette coordination. Lors de l’assemblée générale qui a vu sa création, j’ai donné la position syndicale(appuyé par les secrétaires du SE et du SNUIPP) : coordination oui, mais les décisions de celle-ci sont soumises aux directions syndicales mais à coordonner les actions et à « surveiller » les représentants syndicaux.
Cette coordination a tenu ce cap, permis la participation de nombreux non-syndiqués dont certains envisagent de reprendre une carte.
Le mot UNITÉ a été au centre des préoccupations. Grâce à cette unité, les assemblée générale ont vu le nombre de participants toujours plus grand.
Le relevé de conclusions de la réunion A.E.F.E./syndicats du 14 juin, a partagé les présents aux assemblées générales, Rabat et le reste du Maroc a levé les mots d’ordre de grève, Casablanca (toujours la méfiance) a tenu jusqu’à la visite de M. Verclytte.
Je ne sais pas, ayant dû quitter le Maroc fin juin, ce qu’il est advenu des négociations sur les contrats locaux ouvertes en juillet.
J’ai tenu la représentation du SGEN auprès des autorités marocaines et de l’A.E.F.E. Le SGEN a été présent à toutes les réunions importantes. Yves Le Mignant, de Casablanca, reprendra le flambeau. Marie-Paule Sanvicens s’occupera du premier degré. Une réunion de rentrée décidera de la distribution des rôles vis à vis de l’A.E.F.E.
Pour le mouvement sur les négociations A.E.F.E., des assemblées générales auront lieu dès le jour de la rentrée.
Avant de partir vers Agadir, je voudrais saluer l’investissement de Yves Le Mignant dans ce mouvement, ainsi que celui d’Hélène Ménard. Je ne peux continuer à représenter le SGEN au Maroc mais j’aiderai volontiers ponctuellement sur des dossiers sur lesquels je suis compétent.
Bernard Cantet
Canada (Montréal) :
À Montréal la section SGEN CFDT a assuré et affermi sa présence dans les différentes instances de concertation de l’école, il a été beaucoup plus facile de partager l’action syndicale avec le SNES cette année grâce à l’arrivée d’un nouveau secrétaire plus ouvert qui communique l’information et accepte d’entendre des points de vue différents. Nous avons appris qu’il était tout à fait possible de se concerter en gardant la personnalité de chaque syndicat.
Les deux établissements de Montréal restent marqués par le statut de subrogation qui nous place en situation ambiguë comme vous le savez déjà et ça continue :
· pas de solution au problème de la double cotisation de sécurité sociale, il reste le problème en suspension de l’apurement de la dette. Les collègues qui avaient refusé de payer les cotisations en France se voient réclamer les versements.
Lors de la présentation du projet législatif sur les doubles cotisations retraites et cumul de pensions, il nous a été annoncé l’obligation de cotiser de nouveau au REGOP (alors que les services consulaires nous avaient fortement incités à en sortir en 1994) et si on le souhaitait au régime français des pensions. Cette annonce a suscité des protestations très vives car dans la pratique cela entraînait encore une fois une double cotisation qui aurait à terme découragé les résidents actuels et futurs. Encore une fois le statut de l’école qui nous rend dépendant de deux employeurs nous est apparu ambigu et a relancé l’intérêt pour la participation. Quel a été le rôle du SGEN CFDT et des syndicats en pareil cas ?
· informer au mieux, au plus exact possible sur la participation.
· rassurer les recrutés locaux qui verraient alors leur syndicat local diminué des résidents inscrits et cotisants obligatoires.
· promouvoir aussi la participation.
Voilà pourquoi j’ai demandé des informations sur la liste de discussion Internet dans le courant de l’année.
Il apparaît de plus en plus que la participation se fera qu’on le veuille ou non par volonté administrative car lors d’une mission d’inspection du MAE des établissements scolaires et consulaires au Canada en mai (au Québec l’inspectrice générale était Mme Bonnaud) il nous a été affirmé que la subrogation était dérogatoire et que si la situation était appelée à durer l’A.E.F.E. déconventionnerait les deux établissements de Montréal. Je vous donne ici mon impression à propos des deux établissements :
· Au collège Stanislas la structure de l’école c’est à dire la corporation toute puissante pèse de tout son poids pour empêcher le processus vers la participation qu’elle voit comme une perte d’autonomie, de pouvoir. La pression politique sur les responsables québécois est forte et entendue. On peut voir Stanislas est comme un bien culturel du Québec !
· Le collège Marie de France est un établissement plus directement relié à l’A.E.F.E. conventionné, homologué appliquant à la lettre toutes les directives ministérielles pédagogiques et administratives, il semble prêt à passer en participation. Les deux écoles vont-elles être dissociées dans ce processus ? Certains le souhaitent ? Dossier à suivre…
Notre situation et nos problèmes spécifiques nous ont laissés isolés ; de ce fait nous avons suivi les résultats des négociations A.E.F.E. – syndicats mais s’ils ne s’appliquent pas à Montréal, nous n’étions pas directement concernés si bien que nous n’avons pas lancé de mouvement de grève, le SNES quant à lui n’a pas appelé à la grève non plus car à ses yeux cela défendait les intérêts des expatriés alors que les résidents étaient aux prises avec des problèmes multiples. C’est sur l’esprit et les modalités de réforme de l’A.E.F.E. que nos divergences sont les plus nettes.
Colette Butet
Autriche :
L’ensemble du travail syndical s’est fait dans le cadre d’actions intersyndicales.
Prime de cherté de vie :
Le Lycée Français de Vienne a fait partie des trois établissements européens qui devait voir supprimer les primes de cherté de vie. Ces primes ont toujours fait l’objet de négociations et les accords signés localement ont toujours été avalisés par l’A.E.F.E. La lutte s’est immédiatement radicalisé et des préavis de grève ont été déposés, nous avons eu la chance localement d’avoir eu comme responsable des négociations soit le Conseiller culturel, soit son représentant. La grève a été évitée et le statut quo maintenu.
Calendrier scolaire :
Un deuxième point qui pose chaque année problème est celui de la négociation du calendrier scolaire, notre chef d’établissement voulant absolument l’aligner sur celui de la France sans tenir compte de la surcharge de travail des élèves qui doivent suivre un enseignement autrichien de 6 heures hebdomadaires.
Lorsque les mots de grève nationaux sont arrivés en mars, la mobilisation a été réduite car nous sortions relativement épuisés des conflits locaux.
Négociations A.E.F.E.\syndicats :
Les négociations des modifications du décret 90 ont été suivies attentivement et les personnels sont prêts à se mobiliser si les négociations devaient ne pas aboutir au mieux des intérêts des personnels.
Les préaccords du 14 juin vont dans la bonne direction et localement la grande majorité des syndiqués désirent aller vers le statut unique modulé par des primes correspondantes aux différentes situations.
Le Lycée a vu se mettre en place un plan informatique qui ne semble pas toujours bien en phase avec les nouvelles évolutions pédagogiques (TPE, travail personnel des élèves.). La formation n’est pas prise en charge par l’établissement, le chef d’établissement pensant que chacun doit y pourvoir à titre individuel.
En conclusion, nous sommes en position d’attente sur de nombreux dossiers.
D. Luquet-Dörflinger
CLA – centre de linguistique appliqué de Besançon :
Le problème de la précarité des non-titulaires reste un problème constant du CLA, il touche principalement les administratifs. Leur situation est compliquée par le fait que dans la situation actuelle, s’ils étaient titularisés, ils devraient quitter le CLA. En effet, le Centre, dans le cadre actuel de l’Université de Franche Comté, n’ayant pas d’étudiants qu’il certifie n’a pas droit à un contingent d’administratifs titulaires. La section pense qu’une solution pouffait être la transformation du centre en Institut.
La section se pose aussi le problème de la continuation de son affiliation au SGEN de l’étranger ou de rejoindre la section du Doubs. Alain Schneider rappelle que c’est la section du CLA qui avait choisi d’adhérer au syndicat de Étranger et que c’est donc aux adhérents de la section d’en décider. En cas d’adhésion au Doubs, un lien pourrait être gardé par la présence au Conseil Syndical d’un membre de la section comme c’est le cas actuellement avec Thierry Lebeaupin.
CIEP :
La direction de l’établissement et la façon dont sont vues par le directeur, les relations avec le personnel reste une source de conflit. Les engagements pris n’ont pas été respectés, la concertation ne joue pas. Mouvements du personnel et lettre collective rédigée en réaction a cette attitude ont suscité une violente réaction. Seul le départ du directeur pourrait instaurer un meilleur climat. La section SGEN-C.F.D.T. a connu une progression.
Marie Lakermance
Guinée :
L’installation en poste d’Yves Simard, ancien membre du conseil syndical a permis la création d’une section C.F.D.T.
Portugal :
Lycée de Lisbonne. Bon climat dans l’établissement. La section demande que ne soient pas oubliés dans les négociations avec l’Agence les droit aux postes à mi-temps et les possibilités de cessation progressive d’activité.
Grande-Bretagne – Londres :
L’année a été marquée par des conflits locaux au primaire comme au secondaire au lycée français de Londres.
Institut: Tout le personnel administratif et de service a été mensualisé ainsi que de nombreux vacataires (tous ne l’ont pas souhaité). La concertation fonctionne bien.
Retour au sommaire Retour à la page d'accueil
Fonctionnement du syndicat et syndicalisation : intervention de Jean-Paul Bergault, chargé de l’organisation et de la syndicalisation à la fédération SGEN-C.F.D.T.
Jean-Paul Bergault rappelle que le prochain congrès fédéral du SGEN-C.F.D.T. est prévu à Libourne du 14 au 18 mai 2001. Une réflexion va être entamée sur les difficultés de fonctionnement de la fédération, en particulier sur les points suivants :
· les jeunes militants
· le fonctionnement en syndicats (117 syndicats dans la fédération)
· la baisse des moyens financiers (20 % de diminution des recettes depuis deux ans à la fédération)
Le calendrier du Congrès est le suivant :
· septembre : définition des textes à présenter au Congrès
· Toussaint : Présentation pour amendement d’une première version des textes à tous les syndicats de la fédération (réflexion jusqu’en janvier)
· mars : candidatures pour le conseil fédéral SGEN et pour la commission exécutive.
Les points abordés ensuite sont :
- applications des 35 heures aux salariés du SGEN
Les 10 salariés du SGEN bénéficient déjà d’accords collectifs pour les horaires de travail. L’application des 35 heures se fera en adaptant les accords existants.
- position du SGEN sur les accords signés par la C.F.D.T. pour l’UNEDIC.
Beaucoup de nos adhérents critiquent un syndicat qui leur parait “aux ordres du MEDEF”. la position du SGEN est qu’il y a eu un déficit sérieux de communication sur ce problème particulier. Le conseil fédéral a d’ailleurs adressé un texte à Nicole NOTAT à ce sujet. Cependant le texte même des accords est beaucoup moins défavorable qu’il n’apparaît dans les commentaires de la presse. (rappel : le texte est disponible depuis un mois sur le site http://www.cfdt.fr).
- arrivée des nouveaux ministres à l’Éducation nationale et à l’enseignement professionnel.
Pour le moment le SGEN n’a aucune information autre que celles diffusées par les médias sur les intentions de Jack Lang ou de Mélenchon.
Les participants au Congrès insistent sur l’importance d’expliciter le plus largement possible les positions du SGEN sur l’éducation, en particulier par nos relations avec les associations de parents d’élèves.
Orientations du SGEN-C.F.D.T de l’Étranger pour les années 2000-2003
Il s’agit de fixer, dans la perspective du prochain congrès, les objectifs généraux du syndicat sur des axes prioritaires pour aboutir à un nouveau texte.
Quatre groupes de travail sont formés ; ils devront aboutir à une première version pour le conseil syndical de décembre.
1. La situation des recrutés locaux et la précarité (Philippe Blanzat, Thierry Lebeaupin, Georges Villarmé)
2. L’enseignement dans les TOM (Françoise Rousselet, Robert Jeannard, Alain Schneider)
3. La coopération internationale : coopération linguistique, instituts, aide au développement (Dominique Desbois, Yves Simard, Alain Schneider)
4. L’enseignement français à l’étranger (Daniel Moreau, Françoise Fournié, Dominique Luquet)
Objectifs :
Le congrès souligne par ailleurs comme tâches prioritaires pour le conseil syndical et le secrétariat national:
- la reprise des discussions à l’A.E.F.E. à propos de la modification du décret de 1990,
- la préparation du congrès fédéral du SGEN-C.F.D.T.,
- les élections paritaires qui auront lieu au printemps 2001,
- les problèmes posés par le mode de recrutement aux Affaires Étrangères,
- la situation de l’enseignement dans les TOM.
Enseignement français à l’étranger : statut et rémunération des personnels A.E.F.E. (révision des textes de 1990)
La renégociation du décret de 1990 à l’A.E.F.E.:
Dominique Luquet fait le point sur les négociations. Actuellement, comme cela à déjà été exposé dans le bulletin deux voies se dessinent:
- la voie A :
Il est prévu un statu quo pour les expatriés (mais le nombre ira encore en diminuant en raison de la politique du coût constant) et une amélioration pour les résidents mais le problème des faux résidents reste posé dans ce modèle, l’interruption de carrière permet d’établir une distinction avec la situation administrative des expatriés et évite ainsi à l’administration des recours juridiques que pourraient lui attenter les résidents recrutés depuis la France par les établissements à l’étranger.
- La voie B :
Un statut unique comportant un socle commun: le traitement indiciaire et des avantages afférents, une prime d’expatriation modulable en fonction de la mobilité. Le problème des faux-résidents est ainsi supprimé et nous pouvons espérer réussir à obtenir des postes pour les recrutés locaux titulaires ou qui sont titularisé à la suite du passage de concours. L’augmentation du nombre des recrutés locaux dans les écoles de l’étranger doit être contenue.
Donc en conséquence, le congrès rappelle en préalable qu’il reste en désaccord sur le décrochage des personnels des établissements d’enseignement du décret de 1967, de même qu’il l’était déjà lors de la discussion du décret de 1990.
Des deux options de réforme envisagées par le ministère : maintien de deux statuts, d’une part expatriés, d’autre part résidents avec 15 % de l’indemnité d’expatriation des expatriés et le supplément familial ou bien statut unique offrant aux personnels acceptant la mobilité des avantages dégressifs, le SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger opte pour le statut unique.
Il se prononce pour que les personnels d’encadrement soient dans le statut unique, contrairement aux prévisions du ministère.
Il demande que les indemnités prévues par le nouveau décret évoluent parallèlement à l’indemnité de résidence du décret de 1967 et qu’il soit fait explicitement référence au décret de1967 dans le nouveau décret.
Il demande le bénéfice des avantages statutaires pour les personnels détachés (primes, CPA, mi-temps, congé parental…)
Il revendique l’application des dispositions de changement de résidence aux personnels soumis à la mobilité.
Il demande que la carte scolaire prévoie au moins un nombre de postes budgétaires conforme aux normes d’encadrement de l’éducation nationale et permette la création de postes de résident que pourrons occuper nos collègues recrutés locaux titulaires.
Concernant l’amélioration de la situation des recrutés locaux, dont la discussion fait partie intégrante des discussions sur la rénovation du décret de 1990, le SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger demande :
-
une approche globale des problèmes, incluant les recrutés locaux de tous les services de l’État à l’étranger.
-
la création de « conventions minimales » traitant du contrat, de la rémunération et des avantages sociaux des personnels recrutés localement, conventions conditionnant l’homologation des établissements par le MEN, pour ce qui est des établissements d’enseignement.
-
pour les établissements en gestion directe ou conventionnés, une rémunération minimale correspondant à la rémunération en France, la possibilité de passer les concours internes et de faire le stage dans l’établissement.
La coopération internationale
Concernant les procédures de recrutement, le SGEN-C.F.D.T. revendique une plus grande transparence dans le traitement des demandes tout au long de la chaîne hiérarchique, transparence qui passe par une plus grande implication des instances paritaires (CCPM en cours de réforme).
En particulier il demande :
-
que l’instance paritaire soit consultée sur les modalités de création des emplois et sur la manière de les pourvoir.
-
que les organisations des personnels disposent en temps utile de l’ensemble des candidatures déposées auprès de l’EN.
-
que les candidats puissent faire acte de candidature non plus seulement sur trois postes précis, mais sur des zones géographiques et en fonction de leurs compétences.
-
que l’examen des dossiers déposés à l’EN débouche sur la création d’un vivier où seront choisis, après examen en CCPM, les candidats retenus pour les postes à pourvoir.
-
que toute sanction d’un personnel dans son emploi de détachement soit soumise à l’avis des commissions paritaires.
Le SGEN-C.F.D.T. demande une meilleure information des candidats sur la réalité des postes à pourvoir.
Il dénonce les dysfonctionnements qui se sont produits au niveau local et académique dans le traitement des demandes qui ont fait que l’accès aux candidatures n’a pas été équitable.
Retour au sommaire Retour à la page d'accueil
Mayotte
Françoise Rousselet présente un constat de la situation scolaire à Mayotte :
-
enfants non francophones,
-
faiblesse de l’encadrement dans le primaire,
-
examen d’entrée en sixième peu fiable,
-
besoin d’encadrement hors temps scolaire
-
ourses scolaires plutôt perçues comme aide sociale pour la famille,
-
insuffisance d’un enseignement professionnel, alors qu’il offrirait des débouchés localement.
En bref, le système scolaire métropolitain, transposé à Mayotte de par la volonté de la classe politique mahoraise n’est pas adapté.
Le SGEN-C.F.D.T. rappelle la demande qu’il formule depuis de nombreuses années : que les personnels affectés à Mayotte reçoivent une formation en FLE ainsi qu’aux réalités de l’enseignement dans la collectivité départementale.
Une commission issue du conseil syndical sera chargée de rédiger un texte d’orientation sur Mayotte.
Renouvellement du secrétariat national et du conseil national
Le congrès regrette l’absence d’un certain nombre de représentants bénéficiant de décharges syndicales locales. Un conseil syndical débattra des dates les plus favorables pour le prochain congrès.
· Le secrétariat général du SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger est dorénavant assuré à temps complet par assisté de :
· Alain SCHNEIDER, secrétaire national (Coopération internationale) en poste à Bratislava (Slovaquie).
· Dominique LUQUET-DOERFLINGER, secrétaire nationale (Enseignement français à l’étranger) en poste à Vienne (Autriche).
· Monique EL QACEMI, secrétaire nationale (syndicalisation et trésorerie), en poste à Paris.
Le secrétariat national compte également parmi ses membres bénéficiant de décharges partielles :
· Marie-Jeanne DALI,
· Gilles HUSSON,
· Constantin KAÏTERIS.
Marie LAKERMANCE nommée sur un nouveau poste quitte le secrétariat national et nous tenons au nom du nouveau bureau à la remercier pour le travail sérieux qu’elle a assuré toute cette année.
Françoise Rousselet et Denis Lamour sont nommés commissaires aux comptes.
La composition intégrale du conseil syndical est disponible sur le site Internet du SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger.
Retour au sommaire Retour à la page d'accueil
Réunion commune du
syndicat C.F.D.T des Affaires étrangères
et du SGEN-C.F.D.T de l’étranger
Les débats ont abordé les problèmes liés à la situation et au devenir des coopérants et assistants techniques contractuels (détachés ou non fonctionnaires). Ils ont permis l’adoption d’une motion générale sur l’aide publique au développement, reproduite ci-dessous.
L’aide publique au développement : un devoir de solidarité
Une aggravation de la situation depuis les années 80
L’Afrique fait, trop souvent, les gros titres des tabloïds occidentaux en matière de guerres civiles, développement du SIDA, corruption et autres calamités naturelles ou provoquées par l’homme.
L’aide publique au développement est, parallèlement, en baisse constante, la France se positionnant d’une façon peut-être moins critique que d’autres, mais avec une aide en baisse d’un tiers en quatre ans.
Les institutions de Bretton Woods continuent à imposer des plans d’ajustement structurel sous-tendus par une idéologie libérale qui aggravent les inégalités sociales en laissant les plus pauvres sur le bas côté et les projets financés par la Banque Mondiale qui répondent avant tout à des schémas pré-établis par des technocrates internationaux plus que bien payés sur des fonds remboursables par les pays assistés.
La communauté européenne éprouve encore aujourd’hui des difficultés de bonne gestion de ses financements, pourtant importants, ceux ci étant trop souvent marqués par une sous consommation des budgets alloués, voire même par des détournements.
L’objectif de 0,7 % du P.N.B. à consacrer à l’A.P.D., fixé il y a plusieurs années par l’O.C.D.E., n’est atteint que dans certains pays du nord de l’Europe, la France se situant tout juste à la moyenne avec 0,32 % et les États Unis, restant à un taux ridiculement bas, considérant, pensée unique et mondialisation obligent, que le marché va tout régler, qu’il faut remplacer l’aide par le marché.
Une réforme de la Coopération indispensable mais qui reste à faire
La réforme de la coopération, intervenue en 1998, devait être l’occasion de revoir en profondeur le dispositif français, de dépoussiérer les procédures et de répondre à notre « obligation de moyens », l’obligation de résultats dépendant également de l’efficacité des pays bénéficiaires.
Il n’en a rien été :
- Bercy reste tout puissant et ce n’est pas le changement de dénomination de la Caisse Française de Développement en Agence qui règle quoi que ce soit, bien au contraire, les moyens de celle ci ayant été augmentés au détriment des autres outils de l’aide.
- La fusion des administrations des Affaires Étrangères et de la Coopération aurait du être l’occasion d’additionner les deux démarches, celle de la stratégie d’influence de la France à l’étranger et celle de l’aide au développement mais il n’y a eu qu’une absorption de la « coopé » par le MAE.
- Les flux d’aide ont continué à baisser, ceci malgré la croissance économique retrouvée et l’augmentation du nombre de pays inscrits dans la Z.S.P.
- Les personnels, qu’il s’agisse de ceux de La Rue Monsieur ou des Assistants Techniques, agents de développement sur le terrain, se sentent floués, leurs postes étant supprimés ou transformés et leurs compétences non reconnues.
- La création de la Z.S.P., zone de solidarité prioritaire, était l’occasion d’en finir définitivement avec le pré-carré des réseaux politico-mafieux, mais on s’est plutôt contenté d’augmenter le nombre de bénéficiaires d’une aide en baisse dans un système où le saupoudrage concerne à la fois les pays les moins avancés et ceux à revenus intermédiaires.
- Alors que des programmes électoraux prévoyaient la création d’une véritable agence de développement, outil permettant plus d’efficacité à l’international, l’administration des affaires étrangères calque, aujourd’hui, l’ensemble des procédures sur celles qui pré-existaient dans les ambassades. Ceci conduit aujourd’hui à des situations kafkaïennes qui, au lieu d’augmenter l’efficience du dispositif, le rende encore moins crédible vis-à-vis de nos partenaires.
- Les interventions des O.N.G. et de la coopération décentralisée continuent à se développer et à être financées largement par le budget des services de la Coopération, mais sans véritable coordination et, trop souvent, au seul bénéfice de quelques O.N.G. « institutionnalisées » qui ne représentent que très imparfaitement la société civile.
- La coopération française est encore la plus présente sur le terrain, grâce en particulier à son réseau d’assistance technique directe, mais nous laissons aujourd’hui de plus en plus la décision aux bailleurs multilatéraux qui, à coup de consultants internationaux et autres recettes, imposent progressivement la pensée unique américo-fmiesque. Notre décision d’aider ou de ne pas aider un pays théoriquement liée aux arbitrages des institutions de Bretton Woods, affaiblit notre libre arbitre et notre position vis à vis de nos partenaires.
Grâce à la croissance retrouvée, mettre en place les moyens nécessaires est possible !
Le gouvernement français doit se donner aujourd’hui les moyens d’une véritable politique :
- Une augmentation volontariste des crédits visant, grâce aux fruits de la croissance retrouvée, à atteindre en trois ans l’objectif de l’OCDE : 0.7 % du PIB, notre exemple devant être les pays du nord de l’Europe et non le « trade, not aid », pensée unique de la mondialisation de l’économie.
- Une véritable politique d’allégement de la dette mais en donnant aux pays bénéficiaires les moyens d’une meilleure gestion.
- Le maintien d’un service public du développement par le redéploiement des effectifs des agents sur l’ensemble des pays de la Z.S.P., en fonction des besoins, et le maintien d’un vivier d’agents expérimentés constituant un véritable vivier de développeurs. Ces agents, contractuels comme titulaires, devront alterner les affectations en poste et en métropole dans le secteur international, en fonction de leurs compétences.
- Une réforme institutionnelle profonde donnant une prééminence au pôle technique et politique, animé par le Ministère délégué à la Coopération, par rapport à un pôle financier.
- La poursuite des réflexions, en concertation étroite avec les agents concernés, pour la création d’une agence d’exécution des programmes français d’aide publique au développement.
- Une présence plus politique au sein des institutions de Bretton Woods et du Fonds Européen de Développement, au minimum proportionnelle à l’importance de nos contributions, permettant d’influer plus sérieusement sur les politiques prônées par ces organismes vis à vis de nos partenaires du sud.
- Une véritable implication de la société civile et une meilleure coordination institutionnelle, via le réseau d’assistance technique, des interventions des O.N.G. et de la coopération décentralisée.
- Un développement de la notion d’appui aux activités régaliennes de l’état vers l’aide à l’ensemble des institutions, chacune d’elles étant vecteur de développement.
- Une révision des contours de la Z.S.P. donnant une priorité effective aux pays les plus pauvres et une intervention modulée entre les pays en fonction de leurs situations réelles.
La France doit donner l’exemple en matière d’aide aux pays les plus démunis.
La croissance retrouvée nous en donne les moyens.
Retour au sommaire Retour à la page d'accueil
Lettre
ouverte à Monsieur le Ministre délégué
à la Coopération et à la Francophonie
Au moment de la mise sous presse, cette lettre-ouverte pétition a reçu l’appui du SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger, de la C.F.D.T.-M.A.E., du SNES et du SNESUP, de la FPCOM. En attente : la FEN. La signature de chacun peut être transmise à l’adresse suivante : Intersyndicale@malagasy.com
Objet : Avenir de l’assistance technique directe
Monsieur le Ministre,
Nous déplorons ce qui semble être la nouvelle orientation de la politique française de coopération. Les faits semblent montrer que le gouvernement a l’intention d’abandonner la coopération de projet qui repose sur une présence relativement importante d’agents sur le terrain qui effectuent une mission de service public et la remplacer par une coopération d’expertise, de durée très limitée, dont on monnaie la valeur marchande, mais dont l’efficacité dans la lutte pour le développement des pays est extrêmement aléatoire.
Le dispositif français d’assistance technique a subit, depuis de nombreuses années, une déflation de ses effectifs. et paraissait destiné à disparaître. Jusqu’où veut-on aller dans cette voie ?
Nous qui sommes attachés à une coopération qui permette aux pays d’atteindre un niveau de développement durable au bénéfice des populations, pensons que la quasi-suppression des postes de coopérants ne peut ne peut que nuire à la progression vers cet objectif.
Quelques signes indiquent pourtant que cette disparition ne fait pas l’unanimité.
Lors du dernier comité technique paritaire ministériel dont vous avez assuré l’ouverture le 16 mai 2000, vous souligniez notamment l’importance de l’élément humain de notre coopération de terrain qui en fait la spécificité française à conserver, tout en relevant la nécessité de l’élaboration de nouveaux bons textes réglementaires pour la mobilisation de l’expertise comme le préconise le rapport de Jean Nemo (dont vous avez dit, à cette occasion, que vous en approuviez l’ensemble du diagnostic et de ses conclusions prises une par une).
Auparavant, le 25 avril 2000, devant les membres de la commission des Affaires Étrangères de l’Assemblée Nationale, vous vous engagiez à « exposer l’architecture du dispositif retenu lors du prochain débat budgétaire, à l’automne ». Puis, le lendemain le 26 avril 2000, devant les sénateurs vous précisiez « la réduction des effectifs de l’assistance technique a peut-être été conduite de manière trop rapide ; le gouvernement a la volonté de faire intervenir des assistants techniques dans le cadre d’une plus grande mobilité tout en sécurisant leurs conditions d’emploi ; une loi pourrait consolider le statut de ces personnels ».
Le nouveau directeur de la DGCID a également indiqué sa volonté de mise en œuvre de ce rapport lors du séminaire du HCCI, rapport dont nous n’approuvons pas la totalité mais qui constitue une base de discussion pour l’avenir de l’assistance technique.
Il a été indiqué au CTPM réuni au mois de mai dernier que de nouveaux textes réglementaires, pour la mobilisation de cette expertise, allaient être préparés aux fins de publication avant fin 2001.
Nous nous étions alors félicités de cette évolution du discours politique.
Force est de constater que les administrations des Ministères des Affaires Étrangères et du Budget appliquent, manifestement, une autre politique que celle que vous avez indiquée lors de cette réunion, par exemple :
Un texte de refonte de la loi de 1972 avait été annoncé et devait donner lieu à une large concertation. Il va se réduire à un arrêté spécifique pris en application du décret de 1967 : que devient le décret de 1992 ? Ce nouvel arrêté reprendra-t-il la reconnaissance des spécificités de nos fonctions contenue dans le décret de 1992 ? Quelle information dans les postes et vers les coopérants ?
Les suppressions de postes, sur la base des seules contraintes budgétaires imposées par Bercy, se poursuivent, et se poursuivront en 2001, apparemment au profit de missions de courte durée mais dans quel cadre réglementaire ? sous quel statut ?
Les conditions de titularisation des coopérants ayants droit Le Pors restent, pour beaucoup d’entre eux, aléatoires compte tenu du peu d’intérêt manifesté par plusieurs administrations d’accueil,
La reconnaissance d’une expertise internationale, utilisable à la fois en poste et en métropole, est encore très faible, voire inexistante, en l’absence de toute gestion d’un vivier de compétences,
Les postes vacants vont se multiplier suite à l’application immédiate des règles imposées par l’administration en contradiction avec le décret de 1992 – non encore abrogé – et interdisant l’examen d’une candidature d’un agent ayant plus de huit ans d’expatriation ininterrompue, même répondant parfaitement aux compétences techniques requises. Il serait important qu’un bilan des recrutements puisse être rapidement fourni par l’administration afin de mesurer les réalités de la déflation.
Le rapport réalisé par Jean Nemo à la demande du Ministre proposait une période de transition afin de passer d’un système à réformer à une structure modernisée et plus efficace : il n’en a rien été et de nombreux coopérants sont aujourd’hui remis, sans autre forme de procès, aux bons soins de leur administration d’origine ou de l’ANPE. Les structures chargées d’aider à cette réintégration se sont toutes avérées incompétentes ou absentes obligeant à des retours dans des conditions totalement contraires à une bonne gestion des ressources humaines et à une simple reconnaissance du travail effectué par les intéressés.
Monsieur le Ministre, nous sommes encore prêts à œuvrer pour une rénovation profonde de notre dispositif afin de le rendre plus efficace, mieux adapté aux besoins des pays bénéficiaires.
Un préalable est toutefois indispensable afin de rétablir la confiance en montrant la volonté de mise en œuvre d’une autre politique que celle de démantèlement pur et simple dont nous observons l’accélération depuis le mois de mai dernier:
· Participation active des organisations représentatives du personnel à l’élaboration des textes annoncés et large concertation dans les postes auprès de tous les personnels concernés, dont l’ouverture d’un forum spécifique dans le site Internet du Ministère pour permettre la participation effective du plus grand nombre d’acteurs ;
· Débat en commissions paritaires locales et ministérielles avant toutes suppressions de postes et pour procéder aux créations des postes nécessaires dans les pays entrant dans la Z.S.P. ;
· Moratoire de toutes les suppressions de postes prévues pour la rentrée 2001;
· Moratoire immédiat concernant toutes les décisions relatives à la limitation du temps de séjour (4 ans par pays et 8 ans à l’étranger) ou à la durée des contrats (1 an), dans l’attente de la création d’un véritable vivier permettant la gestion des agents ayant des compétences spécifiques en matière de développement et pouvant œuvrer efficacement en poste comme en métropole dans le secteur international. Convocation des commissions paritaires locales et ministérielles pour les quelques cas particuliers ;
· Remise en cause des administrations d’accueil des ayants-droit Le Pors dans tous les cas où leurs compétences, acquises à l’international, ne sont pas correctement reconnues ;
Vous pouvez compter, Monsieur le Ministre, sur notre engagement en faveur de la construction d’un dispositif français plus efficace d’aide publique au développement.
Retour au sommaire Retour à la page d'accueil
3e
Congrès de la C.F.D.T. MAE
objectif
2001 et 2002 : la lutte contre la précarité
Le SGEN-C.F.D.T. de l’Étranger était représenté au Congrès du syndicat C.F.D.T. du M.A.E., tenu le lendemain du sien, le 31 août 2000. Au-delà de différences d’approche dues pour l’essentiel à des histoires professionnelles et syndicales propres, des objectifs communs ont été soulignés que vous pourrez retrouver dans leur intégralité sur le site de ce syndicat à l’adresse http://www.cfdt-mae.org/LDS131.htm.
Notre congrès est un moment important pour la vie du syndicat. Il sanctionne les bilans, permet la rencontre des adhérents mais aussi fixe les grandes orientations de notre action pour les deux prochaines années.
La nouvelle équipe ne manquera pas de chantiers. La réduction du temps de travail (RTT) notamment à l’étranger (le ministère de la Fonction Publique vient de faire paraître un décret le 25 août dernier fixant le cadre de la négociation), la poursuite du dialogue social dans les postes, la fusion des corps, la création d’un institut de formation, le devenir de l’assistance technique et la résorption de l’emploi précaire au sein de ce ministère.
Arrêtons-nous aujourd’hui sur la précarité :
Tout d’abord les recrutés locaux : la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (sic) indique, dans son article 34 :
« Lorsque les nécessités de service le justifient, les services de l’État à l’étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services ».
Explication de texte : il était nécessaire au moment de l’application de la Loi Perben de retirer vite fait bien fait le statut d’agent public aux recrutés locaux sans même qu’au préalable une évaluation soit menée sur la réalité du nombre d’agents français ayant un intérêt à cette titularisation.
Aujourd’hui, les conséquences sont toutes néfastes : l’affiliation obligatoire à un système de sécurité sociale local, quand il existe, avec des cotisations quelquefois disproportionnées à la rémunération des agents et l’obtention d’un permis de travail pour les étrangers. Nous attendons des mesures concrètes de l’administration envers ces personnels.
« Dans le délai d’un an suivant la publication de la présente loi et, après consultation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le gouvernement présentera au parlement un rapport portant sur l’évaluation globale du statut social de l’ensemble des personnels sous contrat travaillant à l’étranger ».
À ce jour, l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (A.E.F.E.) a déjà lancé auprès des recrutés locaux un questionnaire détaillé afin de répondre à la demande du gouvernement. Qu’en est-il pour les recrutés locaux des consulats, des ambassades, des services et établissements culturels ?
La lutte contre la précarité, c’est aussi la définition concertée d’un nouveau statut des contractuels à durée indéterminée (CDI), la résorption des contrats à durée déterminée (CDD) avec l’application du protocole d’accord signé en juillet 2000 à la Fonction Publique par de nombreuses organisations syndicales (future Loi Sapin), l’aide à la réinsertion pour les coopérants contractuels en fin de contrat.
On le voit, les chantiers ne manquent pas. Retrouvez-les dans notre motion d’orientation.